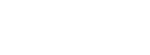Par Aymeric Engelhard
Largement récompensé (notamment à Venise), ce film controversé parlant de la naissance d’une secte marque deux évènements : deux retours en force.
Celui d’un acteur fantastique qui se donne encore et toujours plus aux œuvres auxquelles il participe ainsi que celui d’un des plus grands réalisateurs US. « The Master » constitue donc un immanquable, le premier d’une longue liste cette année. Joaquin Phoenix est de retour. Celui qui joua les enflures chez James Gray (« The Yards ») ou Ridley Scott (« Gladiator ») s’était offert une retraite aux dessous inattendus.
Pour les besoins d’un faux documentaire réalisé par Casey Aflleck, l’acteur avait abandonné le cinéma afin d’entamer une carrière dans le rap. La supercherie marcha d’autant plus que Phœnix arborait un physique d’ours mal léché et n’hésitait pas à créer des scandales partout où il mettait les pieds. Le résultat final apparaît totalement jouissif et prouve le talent d’un homme qui a su repousser les limites de son métier.
Pour « The Master », il revient au cinoche et frappe fort. Arborant une maigreur terrifiante, jouant les grands perturbés, perdus, sexuellement instables et facilement influençables, il nous offre sa prestation la plus intense. Il faut dire qu’il n’a pas choisi n’importe quel film pour refaire parler de lui. Phœnix ajoute un nouveau géant du cinéma à son palmarès de metteurs en scène. En effet, avec six films à son actif et une éternité entre chacun d’eux, Paul Thomas Anderson a acquis une réputation qui le rapproche de Terence Malick ou Stanley Kubrick. Sa propension à faire dans l’intimiste alors même que sa mise en scène et ses sujets invitent à la grandeur démontre son unicité.
Pour exposer la naissance d’une secte dans les années 50 (qui rappelle franchement la scientologie, comparaison démentie par son auteur), PTA retrouve un style qui avait fait toute la magnificence de « There will be Blood ». Utilisation d’un format de pellicule à l’ancienne (le 70mm de « Lawrence d’Arabie » et « 2001 : L’Odyssée de l’Espace »), photographie aux couleurs d’époque, ambiance musicale démesurée et étrange (Jonny Greenwood est un génie), cadres gigantesques, somptueux travellings et plan-séquences d’une rare fluidité.
Paradoxalement, dès lors qu’un personnage ou un visage se retrouve esseulé, il annihile toute profondeur de champ afin de l’enfermer dans le cadre. On s’en doutait depuis toujours, c’est maintenant une certitude : ses compositions de cadres sont les plus chirurgicales depuis Kubrick ! Cette mise en scène fait parfois passer le scénario du film comme secondaire. Mais son écriture touche elle aussi au sublime. Elle s’appuie sur une grande période de doute : l’après-guerre.
Quoi de mieux qu’un ex-soldat pour illustrer la difficulté de vivre après la guerre. Face à un monde en reconstruction, où les gens ne croient plus en rien, une secte a toutes ses chances d’attirer le plus grand nombre. Et Freddie (Joaquin Phoenix) se fera littéralement dévorer par la nouvelle institution mise en place par Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman, fabuleux), gourou grand orateur particulièrement troublant. Plus encore que cette confrontation, c’est dans les second-rôles qu’il faut voir toute la profondeur du script et les préceptes d’une future secte dévastatrice.
Heureusement, PTA n’hésite pas à en montrer les limites et plus encore que ce sujet de fond, c’est bien le portrait d’une Amérique gangrénée de l’intérieur qu’il nous sert. Exceptionnel.